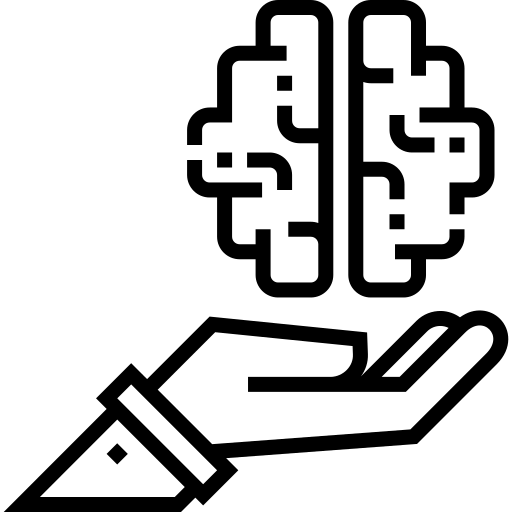J’aime lire. De tout, tout le temps. Je suis tombée dedans petite et après une longue période boulimique sans grand souci de qualité, j’ai découvert la littérature. Ça a été une révélation, comme passer de plats préparés à un restaurant gastronomique (comparaison qui vous aiguille sur la deuxième passion dans ma vie). Je suis depuis devenue difficile, j’ai besoin de savourer les mots, d’aimer les personnages, de me sentir petite face au génie qui se dévoile au fil des pages.
Seulement, voilà, ce n’est pas si simple. Parce qu’en plus d’être férue de littérature, je suis féministe. Il existe bien évidemment des autrices très talentueuses que j’adore lire et relire (Madame de Sévigné, Patti Smith, Simone de Beauvoir pour ne citer qu’elles), mais les femmes qui écrivent et sont publiées sont bien moins nombreuses que les hommes. Dans Une chambre à soi, Virginia Woolf explique brillamment comment la société bride les femmes dans leur processus d’écriture, en les confinant dans un espace domestique où elles n’ont cependant pas de lieu qui leur est propre, et en les plaçant dans une position dominée et subalterne où leur voix n’est pas entendue. À l’inverse, les hommes ont beaucoup plus produit (et de plus gros ouvrages car ils en avaient le temps).
En conséquence, il est plus facile de lire des classiques écrits par des hommes que par des femmes. Quand je lis de beaux livres écrits par des femmes ou des hommes féministes, tous mes chakras sont alignés. Par contre, cela se complique lorsque le livre est magnifiquement écrit et raconté, mais que, fruit de son époque ou de son auteur, il est misogyne. Dans mon cerveau se passe la chose suivante : je calcule un ratio qualité/sexisme très subjectif, qui me guide dans mes lectures. C’est ainsi que je continue de dévorer Proust, mais que j’ai été incapable d’arriver au bout de Marie Stuart de Stefan Sweig. J’adore ces deux auteurs, dont j’ai lu plusieurs romans et biographie. Marcel Proust est mon écrivain préféré, et il en faudrait beaucoup pour que je me prive de sa plume. C’est la raison pour laquelle je lui pardonne sa vision assez réduite des femmes de son âge, qui sont principalement vues comme des objets, des choses à étudier. Cependant la biographie de Marie Stuart m’a vraiment choquée car l’auteur fait des vérités générales sur des traits de caractères féminins de manière répétée, dégradant la nature féminine, sans aucune justification. J’avais l’impression que continuer la lecture serait approuver ce discours, j’ai donc préféré arrêter et me renseigner sur la vie de Marie Stuart par un autre moyen. Cette question du militantisme dans nos choix de littérature avait été posée à Virginie Despentes, reine de la subversion de genre en France aujourd’hui. Sa réponse avait été la suivante (en gros) : mettre son « cerveau féministe » de côté pour ne pas passer à côté de géants littéraires (elle cite ici Charles Bukowski).
Être féministe à mi-temps ? Commençons par la prise de conscience de ce besoin de lutte, en prenant mon histoire (celle que je connais le mieux, mais où d’autres, je l’espère, pourront se retrouver).
Je ne sais pas si on naît féministe ou si on le devient, mais dans mon cas précis, cette conscience de l’inégalité filles-garçons et la volonté de se battre pour qu’elle cesse a démarré très tôt. J’ai ainsi effectué ma première action militante féministe dans la cour de la maternelle. Comme cela devait être le cas dans beaucoup d’écoles, les garçons « « s’amusaient » » à embrasser les filles pendant la récréation, à leur corps défendant. Outrée par ces pratiques, j’avais organisé une réunion de filles victimes de ces attaques, et nous nous étions rassemblées dans la cours en criant « Les filles les plus belles ! Les garçons à la poubelle ! » (slogan depuis breveté), puis nous nous étions ruées en groupe sur les garçons qui nous avaient auparavant embrassées pour leur rendre la monnaie de leur pièce. En parallèle, je commandais un faux kit de ménage rose comme cadeau au Père Noël, donc tout n’était pas encore gagné.
Plus tard, j’ai la chance de faire des études universitaires qui m’ont familiarisée avec la sociologie. J’ai ainsi réalisé que beaucoup de choses que nous pensons comme naturelles sont en réalité des constructions de la société dans laquelle nous vivons, et en particulier sur la question du genre. Ce terme nous est importé des Etats-Unis, et vise à penser les relations de sexe comme des rôles assignés par la société. Autrement dit, ce que nous pensons comme « naturellement masculin » ou « naturellement féminin », n’a absolument rien de naturel mais est le produit de l’histoire de notre société, et plus encore, d’une domination. Des exemples flagrants de ces assignations de genre nous viennent à l’esprit, comme les catalogues de Noël des grands magasins de jouets, qui mettent les pages des filles en rose (avec des kits de ménage…) et celles des garçons en bleu. Mais cette assignation de genre n’est pas souvent si criarde et s’insinue dans tout ce qui nous entoure. Cette omniprésence fait que, hommes comme femmes, nous sommes tellement baignés dans ces injonctions de genre qu’il devient compliqué de savoir ce que nous voulons réellement vis-à-vis de ce que nous intériorisons. C’est seulement à la lecture de La Domination Masculine de Pierre Bourdieu à plus de vingt ans que j’ai compris que la volonté des femmes d’avoir un partenaire plus grand qu’elle était un souhait de soumission et de conformité vis-à-vis de la société.
Le problème du genre est que non seulement il nous met dans des cases qui ne nous conviennent pas forcément, mais surtout qu’il implique un rapport de pouvoir, qui met les femmes dans une position subordonnée dans tous les domaines : dans l’éducation, la politique, la publicité, le monde du travail… et même jusqu’à leur domicile. En ce sens, les études sur les questions de genre ne sont pas faites pour être séparées et coupées du reste, mais bien pour avoir une portée générale sur toutes les disciplines. Or, nous vivons dans un monde androcentré, un monde qui a pour point de référence principal le masculin. Celui-ci est masqué sous une apparente neutralité et universalité.
Ce masculin étant érigé comme neutre, toute approche de déconstruction féministe est alors vue comme une hystérie, une menace pour l’ordre établi. Mais une fois que l’on réalise que ce « male gaze » (regard masculin) est partout, comment continuer à retourner à l’état antérieur, naïf, qui nous permettait de savourer la vie sans jugement ?
J’ai démarré avec l’exemple de la littérature, mais j’aurais pu en citer bien d’autres, où je suis parfois submergée par une impression de schizophrénie : je ne veux pas être victime de construction de genre, et en même temps je veux savourer quelque chose qui a de la valeur pour moi. Comment faire pour vivre sereinement avec cette volonté de renverser un système sans que ceci ne devienne notre seule façon de voir le monde ? Est-ce qu’avoir une vision féministe impliquerait-il impérativement de jongler en permanence entre deux modes ? Un premier mode de suspension de jugement pour pouvoir profiter de réunions de famille sans tiquer sur la répartition des rôles genrés à la fin du repas, savourer Le Mépris sans se questionner sans cesse sur la justification de la nudité permanente de Bardot au point d’en oublier la mise en scène, d’entendre un collègue parler en généralisant « des directeurs et de leurs assistantes » sans avoir envie de lui faire manger son mouchoir ? Et un second que l’on activerait lorsqu’on aurait le temps afin de revenir sur ces événements, de les analyser et d’en faire un support de mobilisation, de militantisme et de sensibilisation autour de soi ? Mais tout étant question de genre … Où placer le curseur ?
Voici ma proposition de guide de survie féministe :
- Ne jamais laisser passer une remarque sexiste, violente, misogyne qui faciliterait la banalisation de ce genre de discours.
- Réserver une partie de notre temps à savourer notre livre, film, repas en acceptant que le monde entier n’a pas encore fait notre chemin de déconstruction. Se réconcilier avec le fait qu’il est impossible de changer le passé, et donc pouvoir apprécier le génie ancien malgré les inégalités présentes.
- Continuer à avoir une certaine part d’oeuvres venant d’artistes attentif-ve-s au female gaze, à l’égalité de genre et/ou féministes.
- Garder des temps de discussions pour réfléchir à ces sujets, s’informer, sensibiliser nos proches, voire s’engager dans des actions militantes qui permettent de faire avancer l’égalité.
- Identifier des personnes qui sont aussi intéressé(e)s ou passionné(e)s par ces sujets, avec lesquelles nous nous sentons compris(es) et avec qui nous pouvons partager notre expérience sans jugement.
Pour conclure, je ne regrette absolument pas d’avoir ouvert les yeux sur le sexisme systémique de notre société, car j’ai à présent les armes pour lutter contre. Certes, il n’est plus possible de faire marche arrière, mais je suis confiante sur le fait qu’en suivant ces quelques préceptes, je pourrais me sentir en phase avec mes valeurs tout en savourant ce qui mérite d’être découvert !
Mathilde Cortinovis
Photo : ©Alice Murillo / Les femmes réinvestissent la rue
[noptin-form id=89]